Rémy Disdero. 1983. Découvre la Belgique, pays de la mère, en 2005, participant à un programme d’échange de travailleurs européens. Réceptionniste à Liège. Homme à tout faire à la maison de la poésie de Namur. Rencontre Robert Varlez, Jacques Izoard, Ben Arès, David Besschops. Quelques voyages, puis sédentarisation. La poésie pâtit. En tant que lecteur, dépasse les mille ouvrages en 2021. Récemment affublé du titre de “Grand styliste et Marginal de la littérature française”. “Afin d’expliquer peut-être pourquoi je passe à travers les lettres comme un fantôme contorsionniste”.
DISDERO Rémy
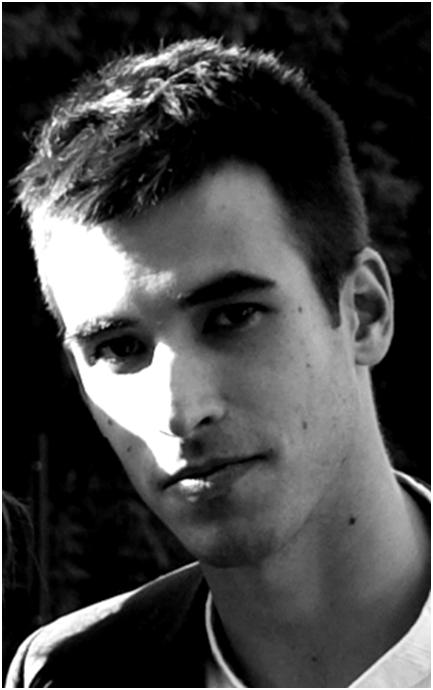
Coordonnées
- Adresse : Poète en errance
Œuvres disponibles à la consultation
Biographie
Bibliographie
- Pronunciamiento, poésie, Thot, 2004.
- Cheval Igloo, poésie, chez l’auteur, 2006.
- Bœuf Solard, poésie, Maelström, 2009.
- Considérations de l’instant, récit, Attila, 2012.
- L’homme au sexe usuel, récit, Le Tripode, 2017.
- Oaristys et autres textes, poésie, Cormor en Nuptial, 2018.
- Tandis que les pains dorment, récit, Le Tripode, 2019.
- Le Récupérateur, roman, Le Tripode, 2023.
Textes
UN CŒUR EN CAILLOU
Le cheval pleure
Sur un lit qu’il a bâti lui-même avec de grands tonneaux
Il montre ses dents et hennit
Le cheval parle puissamment des choses qui lui sont arrivées
Il a une grande marque noire sur son front ridé
C’est un vieux cheval qui n’a pas eu de chance
Son destin était un cœur en caillou
Et un chagrin immense
Et aujourd’hui
Le cheval pleure en pensant
Sur le lit qu’il a bâti lui-même avec de grands tonneaux
Il avait pourtant un cœur immense
Pour aimer et pour aimer
Les fleurs de tous les printemps qu’il ne pouvait pas vivre
Il avait un cœur si grand
Que la première fois qu’il aima
Il mourut de chagrin
Il mourut de chagrin et misérablement
Sans que jamais son amour infini
Trouve la porte du paradis
2005
UN HOMME DE PORC ET DE BŒUF
Je suis un homme de porc et de bœuf
Je ride de l’oreille et maintiens étouffant
Le cri qui me galvaude
Parfums et appétences me lustrent
Je ne cherche
Aucun attachement, pas le moindre soupçon
D’une urne de patience où entasser des liens
Montrant du doigt l’ubac au flanc duquel
Noircit l’aplani, sèche le fini
Et le nez sourit
Soudard d’incohérences
A la lune du triste, au dernier des regrets
Moutard est le support de mon béotien
2011
ELEPHANT BLEU
Toutes les fois que je regarde dans le monde de l’éléphant bleu
La peur me saisit les entrailles de ses tenailles pointues
Et des océans s’ouvrent au dessus de l’univers
Qui me disent comment guider mon bateau ridicule…
J’y vois les élastiques des bouches en bois
Se découper un morceau de bonheur
Dans le monde de l’éléphant bleu
Qui écrase mon âme et chiffonne mes envies.
Tous les poisons que je prends ne me font pas plus fort ;
Cette réalité que tous respectent
Je ne la vois jamais, ni le jour, ni la nuit,
Qu’au devant des forêts de pièges qui me guettent
Toutes les fois que je regarde dans le monde de l’éléphant bleu.
2005
LA DECOUVERTE D’UNE ECREVISSE
J’avouerai donc mon faible pour les rouquines
et pour les demeurées fidèles, même dans l’adversité,
ou pour les cruches timides à doigts de bonnetières,
aux odeurs de savon, aux joues rosies
tant par le froid que par les canicules,
à l’appétit mesuré pour mon porte-monnaie,
aux formes généreuses ou plates comme des raies,
et aux cheveux sans raie, à la bouche humide,
aux dents véreuses, à l’haleine fleurie,
bronzées, les immatures, les possédées,
qui ne sont plus de première fraîcheur,
à la crème épilées, épelées, pelées,
et vous assure de tout mon contentement
à les regarder passer comme de cireuses figures,
les déhanchés incontestables, fourreaux torrides,
à la belle saison défont des anoraks, excédant
une douce surprise quand c’est un mets vert
et un détour de tête ou une volée de bois vert.
2010
FATIGUER SES ERRANCES
Quand tu vois le nuage se lever et qu’il fait nuit, que tu sors de la brume des sueurs d’un train, qu’une odeur d’œuf flotte sur une place peuplée de souteneurs à la petite semaine, Thessalonique qui revient comme sifflement dans l’oreille, des boules quiès fabriquées de vieux mouchoirs de cargo, quand l’aube est là qui amenuise le reste de ton temps, que tu n’as dépensé qu’une demi-pièce de trois sous, quand il pleut par beau temps sur des visages sales et que la diaphorèse écoule des noirceurs au creux des omoplates amaigries de jeûner, quand une lumière opaque aveugle des yeux gourds, quand la ride en pochoir dilate les aigreurs, que la carence en fer, avec autorité, assoie les culs à même de résister au temps.
2008
IL N’Y A RIEN D’AUTRE QUE LE FROID QUI VOUS BERCE
Il n’y a rien d’autre que le froid qui vous berce
et des fous qui vous inondent de rêves avortés ;
des inconscients en sorte qui imaginent un bonheur
où l’on danse en riant
les bras écartés dans une folle allégresse,
une joie sans fin de paillettes qui illuminent
les cœurs incandescents
et des hourras sonores d’infinie gratitude
pour un breuvage à jamais rentré dans les corps
des drogués éclatants aux gencives déchirées
et des fous alléchés par l’odeur du grand espoir.
Il n’y a rien qu’un mort de faim
au ban de la ville ;
que le froid de la nuit qui vient à ronger
les peaux des clochards aux barbes rutilantes.
2004
OREILLES ROUGES
Vous verrez très bientôt
des bras tomber du ciel
des grappes de peaux de boudin
s’avachir au coin des rues
De grands corps seront vidés
Des loques affreuses pendront
à des cordes d’abricotiers
Les femmes auront une règle
dernière et prononcée
Ce sera en vain que l’on courra
et la chair brûlera
comme un fétu de paille
Des tics pousseront sur les visages
Orties, humus, recouvriront
la main et le poignet
Et vous vous réveillerez
sur des civières de mercure
en camisole de force
et le crâne rasé
Oreilles rouges, gorges chaudes,
Un cancer nouveau
finira de vous tuer
2008
CUEILLIR LE DERNIER SOUFFLE
On vous a fait comprendre : la peur est votre nerf. On vous a dépecé d’identité et d’honneur, baladé dans les couloirs d’une industrie de dupe. On vous a enfermé, parcellisé, déguenillé, déchu et épouillé, tordu et caillassé. On a vomi sur vous la mélasse au Quaker de trente-cinq ans de sape à la voix de fausset, détrôné Narcisse en vous, repassé les boyaux, et les petites guiboles de femme sont des obus et des singes, les cauchemars d’enfants sont des hôpitaux blancs. Quoi se mettre à bon dos de mulet distendu ? Quoi penser de se pendre au sortir de l’enfance ? Est-il trop faible pour porter l’écheveau de misaine, tirer la corde affreuse du responsable creux ? Est-il mort ? Pourquoi ces yeux vitreux, ce sable dans les poches ? Et son jean est tombé à des pieds osseux et gris, sa peau a glissé jusqu’au bas des pieds osseux, pour qu’il ne reste plus qu’à cuire trente quatre côtes. Il a joué dans ses os la cantate du freux. Perdu mon polisson, perdue la folichonne, le frisson ne viendra plus ; moissonne le dernier blé, ton bouc est allongé, son dernier souffle sera cueilli par un restant d’Indien.
2008
UNE VERVE D’OREILLER
Voyez, maman, la folle errance
« Je tétais à votre sein »
Ou du singe descendu pour pleurer de sa branche
Comme tout bon happe-lopin
Je veux me souvenir
D’une chose peu en vie qui saignait entre les dents
Et d’une tirelire pleine comme le beau sapin du roi
Mais maintenant comment sans honte me retirer
De ces vulves sanguines
Comment me retirer des naines ébahies ?
La peau de ma veilleuse est mouillée malgré moi
Brait la nuit
Glatit la pleine lune,
Je fouis dans le ramage d’une verve d’oreiller
D’entre mes moufles choit la rognure
Sur le chemin
Derrière l’enfance
Est ce boudoir où j’ai bavé
2010
ETENDARD DES PLEURS
La vigueur, voilà tout ce dont je suis pourvu. Une vigueur passagère, pas même la force de l’âge. Par à-coups des bontés de cœur me saisissent, me dressent à la volonté d’être et de sentir, et comme un linge usé je fais glisser sur moi la couverture du soupirant. Cela induit bien des vigueurs, mais aussi le contrecoup, une apathie ; car tu m’éconduis, ou je le fais tout seul.
Au déjà né, au connu, à l’enfer de l’habit de moine, aux joutes nommées verbales, je pends d’affriolantes nécessités d’expression, je m’accroche à la jupe d’une fille de rien, je me révèle piteux, décati, menteur. Mais le menteur en moi s’effrite, mes partenaires se défont d’obligations tacites, ignorent mes cris à l’aide, déménagent sans prévenir. Si donc toi-même apprends à me faire plier bagage du souvenir où tu me tiens, où restera l’objet qui me constitue ? Ici ? Dans le four d’un village aigre, dans le bois de Meudon ? Au pied de la baronne, aux bras de mes voisins ?
Reste au partage de ma vile affaire, bois ma coupe, porte mon chardon, puisque je veux encore entendre les scansions pénétrantes d’un battement de ce cœur que j’ai tenu pour toi.
Oh, je sais très bien pouvoir ignorer l’appel du souvenir. Je peux vivre en tant qu’adulte, en odeur de sainteté, pousser des gréements sur le passé, m’entretenir une barbiche de joli jeune premier. En tant que tel je ne souffre d’aucune manie dépressive. Mais savoir que tu es, que tu barris à des lieues, que des lieux sont comblés de ta présence, savoir que tu es m’abat, m’étonne, m’assourdit. Tu es, et je suis, à l’accoutumée d’une disparition, à l’acceptation de l’absence. Mais il fait bon encore se promettre, n’est-ce pas, des accolades, des jeux dans les cheveux, des babils innocents, des nuits à se parler. Bien qu’aujourd’hui tout se soit passé entre canard et Pont-à-Mousson, dans ma pièce de lecture, je me suis tout à coup senti coupé de toi. Et la distance, que je sais n’être pas insurmontable, m’a mis dans la gorge une boule de chagrin. Aussi voilà. Je t’écris.
Caracolent les poucets pendant que je détaille une once chaque jour tomber de la ride que je porte entre les yeux comme étendard des pleurs.
2010
SUR UNE COLLINE D’ENFANTS
Je criais dans la maison
Le voisin ne me saluait plus
Ma manie de ranger
Ma précision au lancer
Tout ceci contribuait
A faire de moi un pot étrange
Je m’en remis à une quelconque
Auto-persuasion
Je fis de longues marches
En des pays
Où les langues se tordaient
Où les glottes claquaient
Si j’aimais la sensation de l’ailleurs
Du renouveau et de l’imprévu
Je m’accrochais parfois
A des bouts de paysage
A des chemins noueux
A des parfums de pluie
Maintenant tout ceci me fait pleurer de honte
Parce que j’ai mal au pied
Et qu’une hanche craque
Et que surtout, surtout
Ma volonté s’enfuit
Sur une colline d’enfants
Qui me montrent du doigt
2010
SUR QUEL PIED DANSER
Ne sachant où aller, qui suivre, où me mettre, sur quel pied danser, je suis revenu crécher de ci de là sous rognures… A la petite semaine ! Me nettoyer les ratiches avec un doigt cornu, faire trempette en moule-bite dans une eau plate de crique. Mon toit : le même que par le passé. Ici je dessinais « trente-deux canards en eau douce », « le pont de Saint-Gobain », « trois naines à la repousse ». Aujourd’hui dans le langage je choppe une banane molle et me la fourre au bec, sorti affriolé dévaliser des grands-mères en jouant le piteux.
Oui, triste figure, triste sire, je tends la manche pour incliner des têtes vers des bourses. Revenus qui pourraient, je l’admets, faire servir à courber d’autres têtes, moins chenues, vers d’autres bourses, plus pleines ! Mais pas dans le style de susciter des rencontres hot ! Plutôt de me ferrer dans des coups indémontables, seul, de surcroît ! Avec pour tout joujou-souvenir les tresses d’une étudiante, en mémoire de laquelle, muet, j’irrore ! Ah ! Mon sale préau ranci de vieux singes, illusions borgnes, et je marche, le naïf, frais moqué, frais contrefait, plus piétiné que paillasson, ressassant à larigot ; faudra-t-il que je me plonge dans d’anomiques cuvées ?
2010
C’EST QUAND NOUS SOMMES PLOYES
C’est quand nous sommes ployés et que nous tanguons
Lorsque tu sucres mon palais,
Qu’au devant de ton ventre melliflu je flanche
Et cabre mes démons et nivelle mes furies
C’est lorsque tes pommiers délivrent des oranges, qu’à la vue de ton œil
J’abdique, et me consume et dévale
Une pente infinie, vertigineux d’angines,
C’est alors que mes faims grandissent et me dévorent
Et me vomissent au bord du fleuve opalescent où coulent
Le désir et la haine et l’impatience en rut
L’affreux coléoptère d’amour inavoué
2010
Commentaires
« Une certaine hargne, une volonté de ne pas accepter le réel tel qu’il est, une oscillation entre la violence (même métaphorique) et une espèce d’évasion. L’animalité et le corps sont au premier rang de celle-là. Les dessins font écho à cette violence, à ce refus et à la complexité que cela représente de pouvoir encore donner un visage humain à la monstruosité.» (Ludovic Degroote, Directeur des Editions Ed. de – 12 novembre 2005) « Rémy Disdero nous montre le noir que l’on ne regarde pas en face, la souffrance et la misère des âmes sur lesquelles nous préférons fermer les yeux pour que le monde nous reste merveilleux. Réalisme dans le propos, interpellation par le verbe qui heurte sans choquer. L’auteur illustre lui-même par un trait violent, acide, qui ne laisse pas le lecteur indifférent. Le fantastique proche d’une fiction qui n’est peut-être que notre réalité. » (Bernard Gay-Pageon, Directeur des Editions Thot – avril 2004)