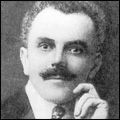De son vrai nom Franz Folie, Franz Ansel naît à Liège le 14 avril 1874. Son père, astronome, futur directeur des observatoires de Liège et d'Uccle, est à cette époque administrateur-inspecteur à l'Université de Liège et c'est dans les bâtiments de celle-ci que l'écrivain voit le jour au sein d'une famille qui compte sept enfants. Le père du futur poète est lui-même épris de poésie. Quand il prendra sa retraite, dans le château du Beau-Mur de Grivegnée, il y accueillera des amis de son fils, Glesener ou Virrès. Au Collège Saint-Servais, Franz accomplit des humanités classiques. Son enfance est ponctuée par les voyages réguliers des siens sur les bords du Rhin. Il y prend le goût des auteurs allemands, Gœthe, Heine et Schiller. Après une candidature en philosophie à Bruxelles, à l'institut Saint-Louis, où il fait la connaissance de Thomas Braun, le jeune homme se lance dans une candidature en droit à Liège. C'est par le biais du jury central qu'il mène ses études à leur terme.
Très tôt attiré par la littérature, on le retrouve sous différents pseudonymes dans La Jeune Belgique, La Revue de Bruxelles, Durendal dont il assumera un temps le secrétariat et bientôt Le Thyrse. Ce sont des poèmes qu'il livre à ces revues, mais dès 1897, il publie un acte en vers : L'Idylle de l'escholier, suivi deux ans plus tard d'une fantaisie carnavalesque Nina-Nino-Ninette. Il faudra attendre plus de vingt ans pour que Franz Ansel (c'est sous ce nom, choisi dans son histoire familiale, qu'il signera désormais ses textes) publie un nouvel ouvrage en volume.
À partir de 1905, établi dans la capitale, il collabore à plusieurs périodiques ou quotidiens, en particulier au Journal de Bruxelles, auprès d'Adolphe Hardy, Ernest Verlant ou Iwan Gilkin. Il y est chargé de chroniques littéraires, de notes fantaisistes ou de souvenirs de voyage. Entré dans l'administration, au ministère de l'Instruction publique où il finira par occuper le poste de directeur des Lettres, il reprend son bâton de pèlerin : en 1907, il rencontre Maurice Barrès en Égypte. La Sicile l'accueille l'année suivante. Il a ajouté à son amour pour la culture allemande une passion pour la Grèce et, par-dessus tout, pour l'Italie. Rome, Florence, Venise et Sienne ont ses préférences et serviront de toile de fond à ses futurs recueils de poèmes.
Cet érudit ne dédaigne pas non plus les auteurs anglais, Keats, Shelley et les intimistes, ni les écrivains du Nord. En littérature française, il avoue volontiers sa dévotion à l'art du théâtre classique, de Corneille à Beaumarchais, et son émerveillement pour Nerval ou Baudelaire, bien que son style poétique personnel demeure obstinément fidèle au modèle parnassien.
Après la première guerre mondiale, en 1919, il accompagne en qualité d'historiographe le roi Albert qui effectue un voyage officiel aux États-Unis, sur l'invitation du président Wilson. Il y prend des notes scrupuleuses pendant près de deux mois, et avant de publier en volume les anecdotes liées à ce périple, il en fait le sujet de plusieurs conférences. L'ouvrage paraît en 1921, enrichi d'une dizaine de photographies. Le grand voyage du roi des Belges aux États-Unis d'Amérique est un récit anecdotique dans lequel Ansel se contente du côté descriptif, sans mettre l'accent sur les aspects politiques ou les implications diplomatiques du voyage.
Ansel est d'abord un poète, et classique de surcroît, malgré les modes qui passent. Il a laissé deux recueils de vers qui font penser inévitablement aux Trophées de José Maria de Hérédia. Les Muses latines, en 1924, est une évocation enflammée de l'Italie, dont il exalte l'histoire et la culture, la civilisation et la beauté plastique. Il retrouve en 1931 le même lyrisme débordant et inépuisable, impeccable quant à la forme, dans La Flamme et la lumière, qu'il dédie à Fernand Severin; il y chante avec passion les contrées où ont vécu Virgile, Horace ou Dante. Ansel accorde aux aspects bucoliques la place prépondérante, donnant à ces volumes qui paraissent désuets à maints critiques un parfum d'antiquité.
Ansel s'est adonné au théâtre dès avant la naissance du siècle. Entre 1925 et 1934, il récidive en publiant trois comédies en vers classiques, qui rencontrent un certain succès, en raison de leur construction parfaite et d'un climat où règnent badinage et situations fantaisistes. L'École de Werther (1925) est joué au Canada, et la création de la pièce en trois actes, Le Codicille, a lieu au Théâtre royal du Parc, à Bruxelles, en 1929. L'École des romanesques est interprété à Paris en 1934. Un conte de Noël, Le Drame de Glancor, dans lequel Ansel utilise le vieux procédé du prince charmant attendu par une princesse est donné à Liège, au Gymnase, en 1936, quelques mois avant qu'il ne tombe malade.
Si l'œuvre d'Ansel est peu abondante en volumes publiés, il faut rappeler qu'il a fourni une longue série d'articles à la Revue générale, de 1924 à 1933. Il y aborde les sujets les plus variés avec une grande maîtrise. Sous sa signature, on retrouve des études consacrées à des auteurs belges (Rodenbach, Picard, Gilkin, Severin), à des écrivains français (Barrès, Anatole France ou Jules Verne), à la culture européenne, de Byron et de Ibsen à Schubert, de Gœthe à Beethoven; il élargit parfois son champ d'horizon et traite alors du catholicisme aux États-Unis ou des cimetières d'Orient. Ces textes forment sans doute l'un des aspects les plus intéressants de sa production. À la fin de sa vie, Ansel se consacre plus spécialement à l'étude de l'histoire de sa famille et à sa généalogie.
Il meurt à Bruxelles, le 27 octobre 1937. Il avait été élu à l'Académie royale de langue et de littérature françaises le 5 décembre 1934.